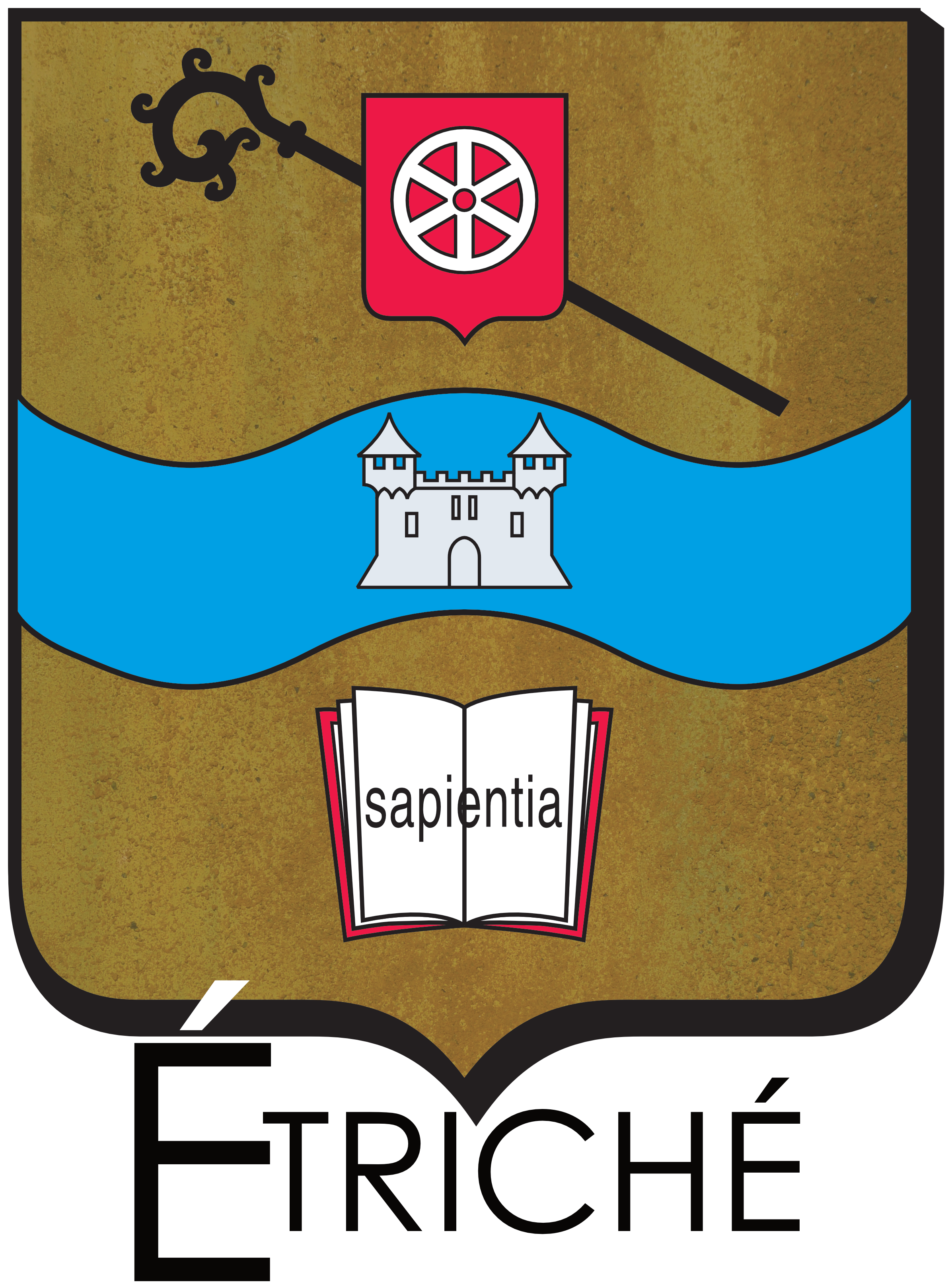La 1re mention historique du nom de la commune date de 1306, la chartre de l’Abbaye Saint Serge indiquant « Locus qui dicitur Estriachus » (le lieu qui nomme Étriché).
Étriché et son blason
Dans le blason, on peut y voir la crosse des abbés de la Roë qui ont été à l’origine du Prieuré du Port l’Abbé.
Les armes de la commune :
D’or à la fasce ondée d’azur chargée d’un château d’argent, accompagnée en chef d’une crosse de sable posée en bande, chargée d’un écusson de gueules surchargé d’une roue d’argent, et en pointe d’un livre ouvert aussi de gueules, les pages aussi d’argent chargées du mot « Sapientia » de sable.

Étriché et ses monuments historiques
PRIEURÉ DU PORT L’ABBÉ

Le Prieuré du Port l’Abbé se situe sur la route du Porage à Châteauneuf.
Depuis 1965, il conserve un ensemble de bâtiments classé monument historique.
Cet ensemble forme l’une des richesses architecturales de la commune.
Cet édifice datant du XIIe siècle sera dédié à St Hilaire, Évêque de Poitiers.
L’église sera déclarée succursale le 30 septembre 1807, la bénédiction aura lieu en 1913 par Mr le Chanoine Bridier.
ÉGLISE SAINT HILAIRE
Celle-ci est composée d’une nef unique et d’un chœur, d’une chaire du XVIIe siècle, d’un autel doté d’un grand vitrail de la Vierge et d’une reproduction du retable de la chapelle du Moulin d’Yvray datant du XVIe siècle.



LE MOULIN D’YVRAY
Article rédigé par LAMY - association Loisirs Animation du Moulin d'Yvray
Le moulin d’Yvray était un village de pêcheurs, d’artisans et de paysans.

Les origines
Les premières mentions du village remonte à 1036 où il est fait référence d’un lieu qui s’appelle « Ivriacus » (Yvré) sur l’actuel commune d’Étriché.
Ancienne agglomération, formée sur la grande voie d’Angers au Mans, aux abords d’un groupe de Moulins, appartenant au XIe siècle, au seigneur de Juvardeil, plus tard au seigneur du Plessis-Chivré.
On en comptait trois au XVIe siècle.
Une porte marinière permettait aux chalands de passer.
Le village était autrefois sur un double passage routier et fluvial, ce qui générait des activités intenses et variées, liées aux métiers de charrons, tonneliers, pêcheurs, passeurs, mariniers, maréchaux-ferrants, hôteliers… Et tous les autres petits métiers vivant directement ou indirectement de la Sarthe et du passage.
La canalisation de la Sarthe
La canalisation de la boire du Poirier vers 1850 et l’élévation du niveau de l’eau au profit de la minoterie de Cheffes ont noyé les anciens Moulins installés depuis le Moyen-Âge sur le bras historique de la Sarthe.
La circulation fluviale fut facilitée par le passage d’une seule écluse au lieu des quatre portes marinières initiales, mais elle était détournée du village. Petit à petit, l’activité du village a décliné.
La construction du port date de 1880 à la demande des habitants du Moulin d’Yvray.
L’arrivée du chemin de fer en 1862
Le trafic fluvial sur la Sarthe a rapidement décliné après la construction de la voie ferrée en 1862.
L’arrivée du chemin de fer a modifié le passage de la route. La circulation a été reportée au-dessus de la ligne. Le village a vu se réduire la fréquentation de passage. La tranquillité s’est installé mais les commerces ont disparu.
C’est en 1980 que la SNCF décide de la suppression des deux passages à niveau et de la construction d’un pont routier, surplombant la voie ferrée électrifiée, pour l’accès direct au village.
La chapelle
Construite à la fin du XVe siècle, elle fut consacrée le 25 novembre 1498, comme l’atteste le document retrouvé dans l’hôtel qui contenait une relique de Saint-Étienne.
Cette chapelle est dédiée à Saint Jean-Baptiste. Elle présente un pignon avec une porte en anse de panier et un clochetons en pierre où, avant la Révolution, pendait une cloche provenant de l’ancien prieuré de l’abbaye de Ferrières.
À l’intérieur, figure une balustrade en bois et un bénitier inclus dans le mur. Le retable (mise au tombeau du Christ) est conservé au musée Saint-Jean d’Angers. Sa reproduction est visible à l’église Saint-Hilaire d’Étriché.
Des mariages furent célébrés dans la chapelle jusque fin XVIIIe. En 1792, la chapelle fut confisquée puis mise en vente et rachetée par trois particuliers qui l’ont conservée en l’état.
La chapelle est mentionnée dans les documents cadastraux depuis 1940.
Les personnages historiques
Madame Marie Chasserie : une martyre de la révolution.
Elle était attachée à la royauté et à la religion. La visite de son fils, engagé dans les armées royales, a généré sa dénonciation par un voisin.
Arrêtée par les patriotes, puis, emprisonnée à Angers, elle fut conduite en même temps que 300 filles vendéennes au Champ des Martyrs pour y être fusillée le 15 avril 1794.
Pierrerit :
Connue sous le nom du « drame du Moulin d’Yvray », cette affaire s’est déroulée il y a 200 ans, au printemps 1817.
Le 4 mai, un noyé est retrouvé à la porte marinière de Porte-Bise. En réalité, il s’agit d’un homme assassiné et jeté dans la Sarthe. Identifié, le cadavre est celui d’un voyageur qui s’est arrêté à l’auberge de la Boule d’Or, le 19 avril 1817.
La victime s’appelle François-Xavier Delœuvre, « un artiste dramatique », parisien, natif de Lyon.
Avant même l’identification du « noyé » qui présente des blessures à la bouche, les soupçons se portent sur la famille Chalumeau, et notamment sur Pierrerit.
C’est son gendre, Louis Ménard, qui tient l’auberge de la Boule d’Or avec sa femme Anne, fille Chalumeau. La famille n’a pas bonne réputation. Leur fortune a grossi rapidement, trop rapidement aux yeux des villageois.
C’est une succession de découvertes et de rumeurs qui vont conduire Pierrerit et sa famille devant le tribunal. D’abord un non-lieu est prononcé à Baugé. Le procureur du roi relance la procédure. Le 14 août 1817, la Cour d’Appel est saisie de l’affaire.
Après l’exhumation du cadavre, l’autopsie confirme la thèse du crime.
La servante finira elle-même par confirmer.
La peine de mort tombe le 3 décembre par la Cour d’Assises.
Cette histoire sordide comprend des rebondissements, implique plusieurs personnes condamnées et exécutées sur l’échafaud.
L’exécution s’est déroulée le jour du Mardi Gras de l’an 1818 sur le Champ-de-Mars à Angers.
Cette saga a marqué les esprits les contemporains et a donné lieu à la rédaction de livres, pièces de théâtre, complaintes, articles.

LE PLESSIS CHIVRÉ

Le Plessis Chivré est une ancienne terre seigneuriale qui relevait de la Chatellerie de Juvardeil.
Les terres de Plessis appartenaient depuis au moins la moitié du XIIIè siècle à la famille de Chivré. Jusqu’à la fin du XVè siècle, aucun document ne fait état de la demeure des Chivré. De cette époque, il ne reste que les douves et probablement une petite partie de l’existant ainsi que la fuye (pigeonnier). La construction de la partie principale du château date du début du XVIè siècle.
La demeure est constituée de deux corps de logis en équerre dont l’angle est marqué d’une grosse tour. En façade, on distingue une double tour d’escalier.
En 1630, le Comte de Chivré cède le château à la famille de Gramont (née Chivré). Celle-ci fit construire en prolongement vers le nord-est un bâtiment terminé par une chapelle. A l’intérieur de cette chapelle, Mme de Gramont fit installer un bel autel à retable.
En 1634, Françoise Marguerite de Plessis Chivré, nièce de Richelieu, épouse Antoine de Gramont, maréchal de France, conseiller d’Etat puis ministre d’Etat, ambassadeur à Madrid, qui épousera par procuration Marie-Thérèse d’Autriche au nom de Louis XIV et organisera son voyage vers la France.
Leur fille Catherine Charlotte épousa en 1660 le prince Louis Ier de Monaco, duc de Valentinois, qui sera appelé à régner sur la principauté en 1662.
En 1690, Catherine de Gramont apporte la terre en dot lors de son mariage avec Alexandre de Canonville, marquis de Raffetot. Louis-Alexandre de Canonville de Raffetot revend le Plessis Chivré à M. Lemarié de la Crossonière en 1780. Vers 1800, celui-ci supprima une partie du bâtiment du XVIè siècle afin d’avoir une ouverture sur le jardin des douves et les bois.

En 1824, M. Ménage en hérite et à son décès, en 1831, la famille de Quatrebarbes en prend possession. A la fin du XIXè siècle, M. Xavier de Quatrebarbes entreprit la restauration du bâtiment principal suivant le goût de l’époque, ainsi que la construction d’autres dépendances et la réhabilitation des parcs et jardins.
Sources :
- “Etriché, d’hier et d’aujourd’hui”, ouvrage collectif, éditions du Petit Pavé.
- Célestin Port “Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine & Loire”, éditions H. Siraudeau & Cie, Angers
- Wikipédia